Texte Jean Genet, mise en scène Arthur Nauzyciel – dramaturgie Leila Adham – travail chorégraphique Damien Jalet – à l’Odéon-Théâtre de l’Europe.

© Philippe Chancel
Genet écrit la pièce en 1957, elle est publiée en 1961 par Marc Barbezat aux éditions de l’Arbalète. Une version édulcorée par Gallimard en 1958 ne verra pas le jour, une autre sera publiée dans les œuvres complètes en 1979. Roger Blin la met en scène en 1966 – quatre ans après les accords d’Évian qui marquent l’Indépendance de l’Algérie – à l’Odéon que dirige Jean-Louis Barrault, dans une grande proximité avec Genet. La pièce avait enflammé l’Odéon*.
La centaine de personnages inscrite au générique de la pièce la rendent difficile à monter et chaque acteur assure de nombreux rôles. Pourtant Berlin en 1961, Vienne en 1963, Stockholm en 1964 la présente. À Londres, Peter Brook dans ses recherches sur le jeu de l’acteur en montre douze tableaux pour quelques représentations en privé, dans une petite salle de quatre-vingts places. Il rejoint les exigences de perfection recherchées par Genet lui-même qui donne des directives très précises : il ne voulait pas d’acteur arabe préférant garder de la distance et prônait grimage et maquillage. « Genet voudrait que les comédiens se préparent comme des acrobates de cirque… » rapportait Brook, allusion aussi au Funambule de Genet, poème d’amour écrit à l’attention de son compagnon, Abdallah. Patrice Chéreau monte Les Paravents en 1983, Marcel Maréchal en 1991.
La pièce traverse l’Algérie coloniale, c’est « une méditation sur la guerre d’Algérie » disait Genet, sur l’oppression et les rapports de pouvoir vus notamment à travers l’armée française et l’OAS – Organisation armée secrète – branche française terroriste et clandestine proche de l’extrême droite pour la défense de la présence française en Algérie. Genet est du côté des opprimés, du peuple algérien et la pièce met en images et en mots ceux qu’il a croisés quand il vivait là-bas. Dans la mise en scène d’Arthur Nauzyciel on se trouve face à un escalier monumental qui barre la scène de bas en haut et de gauche à droite comme un immense mausolée (scénographie et accessoires Riccardo Hernández). Dans cette architecture, le déplacement des acteurs se fait de manière escarpée, incertaine ou aérienne et dans la verticalité, traduction du déséquilibre de cette guerre, de la verticalité du politique et de la domination. L’escalier est aussi un lieu de transition, une évocation de deux grands du cinéma et de l’image : Eisenstein et les marches de la colère dans le Cuirassé Potemkine tourné à Odessa en Ukraine, avec cet escalier du massacre où un landau dévale la pente, ou encore Tarkovski dans Nostalgia.
Apparaît au loin, depuis le sommet de l’édifice, une tête dans le ciel, ou dans les cintres, un tout petit personnage qui finit par prendre corps en descendant l’escalier et se rapprochant de nous. C’est Saïd. « Le ciel est déjà rose. Dans une demi-heure le soleil sera levé… » Harassée et portant une valise pleine de cadeaux sur la tête il est suivi d’une « vieille femme arabe toute ridée », sa mère, venue pour ses noces avec « la plus laide femme du pays d’à côté et de tous les pays alentour. » Elle économise ses chaussures et avance pieds nus, claudicante et défaite, en haillons. « Je vous avais dit de mettre vos souliers ! » dit-il à sa mère. Le langage est rude, la relation aussi. Et l’histoire va principalement se tisser autour de ces trois personnages, les Orties – Saïd (Aymen Bouchou), sa mère (Marie-Sophie Ferdane) et Leïla (Hinda Abdelaoui) dans l’âpreté et parfois l’innommable.

© Philippe Chancel
La pièce a de nombreux contours et détours, de l’implicite à la manière de Genet, qui comme un alchimiste transforme la m…. en or et les mots en épiphanies. Vols et machinations, intrigues, trahisons et lâchetés, sont au cœur du sujet qui mène jusqu’au monde magique et au monde des morts. On est à la fois dans la transcendance et au cœur des bordels qu’affectionne Genet dans sa narration, où les putains sont des déesses et les pleureuses ressemblent à des mouches, ici armées de parapluies – les mouches pour faire la nique à Sartre qui n’avait pas dit que du bien de lui dans son essai Saint Genet, comédien et martyr. « Son autobiographie n’est pas une autobiographie, elle n’en a que l’apparence : c’est une cosmogonie sacrée. »
Les discours des colonisateurs, leurs symboles, bottes, gants, casques, mitraillettes, marseillaises, clairon ; tous les grades, du soldat au sergent, de l’appelé au légionnaire, du lieutenant au général, s’étalent, accrochés à l’escalier comme à la façade d’un pic impitoyable. On dirait des soldats de plomb. Les travestis s’égaient. Il y a Kadija, Warda, Malika, Nedjma, Taleb, Sir Harold et le Banquier, Si Slimane et tant d’autres qui montent et descendent les marches abruptes de cet art brut et minimaliste, entre vols planés, chutes et roulés-boulés dans l’escalier qui finit par devenir le personnage principal de la pièce, tandis que Genet y voyait de grands paravents peints.

© Philippe Chancel
Après l’entracte – le spectacle dure quatre heures – sur écran, un père lit les lettres envoyées de Tlemcen par son fils, médecin et appelé du contingent dans lesquelles il décrivait sa vie là-bas, les paysages et son ennui. On voit un jeune militaire traqué par son lieutenant, on voit des combattants, une vamp, Ommou essayant de protéger Saïd, Naceur. Une très belle séquence entre Saïd et Leïla montre que la fin semble proche. On y perçoit la sensibilité d’écorchée vive de Leïla face à son destin et à la brutalité de Saïd, qui lui dit : « Je veux que le soleil, que l’alfa, que les pierres, que le sable, que le vent, que la trace de nos pieds se retournent pour voir passer la femme la plus laide du monde, et la moins chère : ma femme. » Ce à quoi Leïla lui tenant tête répond avec fougue : « Mais moi je veux – c’est ma laideur gagnée heure après heure, qui parle – Je veux que tu me conduises sans broncher au pays de l’ombre et du monstre… Je veux – C’est ma laideur gagnée minute après minute, qui parle – que tu sois sans espoir. Je veux que tu choisisses le mal et toujours le mal. Je veux que tu ne connaisses que la haine et jamais l’amour…… Je veux – C’est ma laideur gagnée seconde après seconde, qui parle – que tu refuses l’éclat de la nuit, la douceur du silex, et le miel des chardons. Je sais où nous allons Saïd, et pourquoi nous y allons. » SaÏd lui donne un coup de pied, elle dessine à la craie verte un magnifique palmier. On ne la reverra pas. Peu après, on tire sur Saïd comme sur un lapin après les quelques mots solennels qu’il prononce : « À la vieille, aux soldats, à tous je vous dis merde. »
Des cadres blancs descendent du haut, marquant comme une entrée au royaume des morts. Et la mère face à Kadidja déclare : « Saïd ! Il n’y a plus qu’à l’attendre ! » la réponse de Kadidja s’enchaîne : « Pas la peine. Pas plus que Leïla, il ne reviendra. » Tous les personnages remontent l’escalier, lentement, tous les acteurs sont alors sur scène, formant communauté. Saïd et Leïla ferment le ban. Tout en haut et comme pris dans un vertige, tour à tour chacun tombe de l’autre côté du miroir.

© Philippe Chancel
Très chorégraphiée, la pièce fonctionne comme en trompe-l’œil, d’autant avec ce grand escalier. Les corps, déchirés ou cassés, caricaturés parfois, prennent toute leur dimension, agrippés qu’ils sont à l’escalier, comme des araignées à leur toile. Chaque personnage s’inscrit comme sur une portée musicale, solidaires les uns des autres. Pourtant, dans le trio des Orties, la mère semble bien jeune face à Leïla, emprisonnée dans la cagoule-résille chargée d’effacer son visage.
Genet a beaucoup écrit en prison où il a fait de fréquents séjours à partir de l’âge de quinze ans. Il écrit ses pièces, Les Bonnes en 1947 et Splendid’s à la même période, puis entre 1955 et 1961 Le Balcon, Les Nègres et Les Paravents, parmi de nombreux autres textes. Après le suicide de son ami, Abdallah Bentaga, en 1964, il cesse d’écrire, s’engage chez les Black Panters et soutient les Palestiniens. Il est à Beyrouth au moment des massacres de Sabra et Chatila et rédige Quatre heures à Chatila. Il travaille sur Le Captif amoureux quand il disparaît, emporté par un cancer.
De Jean Genet Arthur Nauzyciel a mis en scène Splendid’s en 2015 avec des comédiens américains, recréé en visio conférence pendant le confinement, pièce qui joue sur le travestissement et trouble les identités. Acteur formé à l’école du Théâtre national de Chaillot d’Antoine Vitez, le metteur en scène dirige depuis 2017 le Théâtre National de Bretagne et son école, à Rennes après avoir été directeur du Centre dramatique national d’Orléans et monté une vingtaine de spectacles. Mettre en scène Les Paravents est un projet ambitieux et semé d’embûches notamment par la multiplicité des personnages dans laquelle le spectateur doit accepter de se perdre. Ils sont un pan de l’Histoire longtemps restée cachée et restituent, par le théâtre, un peu de vérité.
Brigitte Rémer le 18 juin 2021
Avec : Hinda Abdelaoui, Léïla – Zbeida Belhajamor, La servante du bordel, Nejma (une pleureuse), la communiante, Djemila (une prostituée) – Mohamed Bouadla, Ahmed, Nestor (légionnaire), un gardien – Aymen Bouchou, Saïd – Océane Caïraty, Malika, une pleureuse, Preston (légionnaire) – Marie-Sophie Ferdane, La mère – Xavier Gallais, Madani, la voix du mort, le lieutenant, l’académicien – Hammou Graïa, Mr Blankensee, le notable, Si Slimane, le missionnaire – Romain Gy, Le gardien de prison, le soldat 1840, fils de Sir Harold, Roger (légionnaire), le voleur – Jan Hammenecker, Sir Harold, Mme blankensee, Jojo (légionnaire) – Brahim Koutari, Bachir, Pierre (légionnaire) – Benicia Makengele, Kadidja – Mounir Margoum, Habib, le gendarme, le général, Salem, le combattant – Farida Rahouadj, Warda, une pleureuse – Maxime Thébault, Le sergent, le reporter – Catherine Vuillez, La vamp, Ommou – et la voix de Frédéric Pierrot. Assistanat à la mise en scène Constance de Saint Remy, Théo Heugebaert – dramaturgie Leila Adham – travail chorégraphique Damien Jalet – lumières Scott Zielinski – scénographie et accessoires Riccardo Hernández, avec la collaboration de Léa Tubiana – sculpture Alain Burkhart – assistanat sculpture Jeanne Leblon Delienne – son Xavier Jacquot – vidéo Pierre-Alain Giraud – costumes, maquillages, coiffures et peinture des djellabas José Lévy assistanat costumes Marion Régnier – coiffures et maquillages Agnès Dupoirier
Du 31 mai au 19 juin 2024, du mardi au samedi à 19h30, le dimanche à 15h – à l’Odéon-Théâtre de l’Europe, place de l’Odéon. 75006. Paris – métro : Odéon – tél. : 01 44 85 40 40 – site : www.theatre-odeon.eu
*Parallèlement aux représentations, L’Odéon présente, en partenariat avec l’Institut Mémoires de l’édition contemporaine (IMEC) une exposition sur la création des Paravents en 1966 à l’Odéon alors Théâtre de France, sous la direction de Jean-Louis Barrault, dont des maquettes de costumes et décors du scénographe André Acquart, des courriers envoyés par Jean Genet au metteur en scène Roger Blin pendant la création du spectacle, ainsi que des photos et articles de presse parus sur le spectacle et le scandale qu’il suscita. En regard, l’exposition présente aussi quelques lettres et commentaires de Jean Genet à Patrice Chéreau lors de sa mise en scène des Paravents en 1983, aux Amandiers de Nanterre.



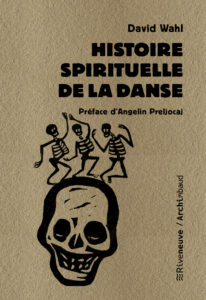

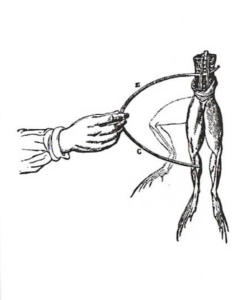























































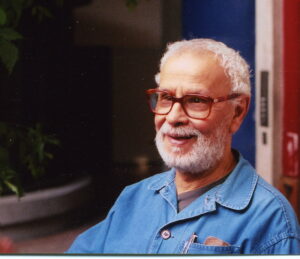













Vous devez être connecté pour poster un commentaire.